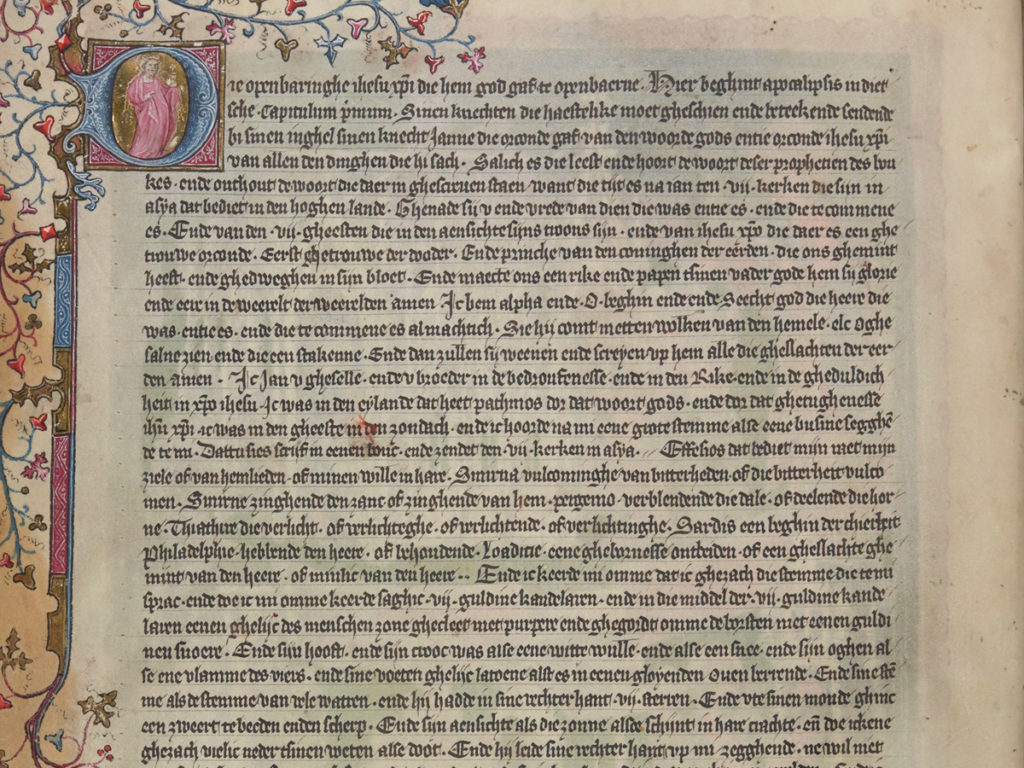Les langues et la Belgique
« C’est pas nous qu’on a commencé ! » Cette phrase, je m’en rends compte, fait très « bac à sable », très jardin d’enfants. Niveau que, je pense, atteignent la plupart du temps nos discussions linguistiques. À une heure où la mondialisation va en s’accélérant, où les défis, qu’ils soient économiques, écologiques ou éthiques, sont les vrais enjeux, nous, nous passons notre temps à scinder des arrondissements judiciaires dont sept milliards cent quatre-vingts millions de personnes n’ont absolument rien à faire, pas plus qu’ils n’ont à faire de convocations électorales qu’on ne pourrait distribuer dans une langue ou encore de guichet d’une administration où la langue des signes doit s’employer en face d’une personne ne parlant pas la langue du lieu alors qu’on connaît très bien la sienne.
Quand les gens apprennent ce qui nous divise, nous sommes la risée de la Terre (si on ajoute à cela les vidéos de Michel Daerden, on atteint des sommets youtubiens) et notre seule satisfaction, c’est de ne pas encore en être arrivés au conflit armé, bien qu’on se souvienne des images d’une personne excédée par les promeneurs flamands du dimanche dans les Fourons qui avait brandi une arme à une fenêtre de son habitation.
En bref, que veulent nos voisins, amis, partenaires, associés, cohabitants (on les appelle comment pour finir ?) flamands. Leur éternelle plainte concernant le risque qu’ils ont couru de perdre leur identité face au français peut, fort facilement, mais personne ne le fait jamais, être battue en brèche par le « wallon » qui, lui, n’a pas su ou pu sauver son (ou ses) parler d’origine autrement que dans une certaine forme de folklore qui lui aussi tend à disparaître.
Pour rappel, le wallon est une langue romane qui est nettement et définitivement individualisée dès le début du XIIIe siècle. Il restera jusqu’au début du XXe siècle la langue parlée par la majorité de la population de la moitié de la Belgique, car, comme en Flandre, le français y est seulement la langue des lettrés et des classes supérieures et la seule langue pour les textes officiels. L’ensemble du petit monde des ouvriers et des paysans parle son dialecte wallon parfois différent d’un village à un autre ; de nombreuses communes tiennent même leurs conseils communaux aussi en wallon.
Comme en Flandre pour les dialectes ou patois flamands, une politique d’éradication du wallon à l’école s’est mise en place. Elle se fait de la même manière que celle de l’école de la troisième République française qui assimilait dans une même répression « cracher » et « parler breton » ! En Wallonie aussi, être surpris à parler wallon pouvait valoir une punition à l’école primaire. Cette politique de l’école va être relayée par la famille qui, à partir des années 1920, va aussi mettre un point d’honneur à ne plus transmettre le wallon mais à élever (dans tous les sens du terme) en français. Tout cela s’expliquant bien entendu par un important désir de promotion sociale.
Le dramaturge wallon Jean-Marie Piemme parle admirablement de ce phénomène dans une conférence donnée en juillet 2010 à l’université d’Avignon. « Mais l’expérience de la disparition a pour moi d’autres visages encore. Elle s’identifie par exemple à l’interdiction qu’on me fait, alors que je suis tout jeune enfant, de parler le dialecte de ma région : le wallon. Là où j’ai grandi, on parlait le wallon et le français. Mon trajet scolaire imposait la disparition du wallon et le choix du français. La rue m’avait appris le wallon, mais ce wallon devait disparaître au profit du français, parce que « avec le français on peut aller loin alors qu’avec le wallon on ne va nulle part. » (…) « J’ai donc vu disparaître en moi l’enfant de la rue, parlant le wallon, sociologiquement destiné à l’usine d’en face. J’ai été arraché à ce destin par un père volontariste qui projetait sur son fils les études qu’il n’avait jamais pu faire.»
J’ai connu deux de mes arrière-grands-mères dont une « pure Liégeoise », née en 1880, pour qui le français était une langue étrangère vaguement comprise. Lors des quelques moments qu’elle a passés à l’école, il lui était interdit de parler le wallon ; elle était même punie pour ça à l’époque. Tout comme il était aussi recommandé aux instituteurs wallons de commencer en première année par apprendre à leurs élèves une centaine de mots français avec leur traduction wallonne. Et si elle ne l’a pas fait parce que l’école elle ne l’a pas beaucoup fréquentée, ses enfants, eux, l’on fait, et le wallon, petit à petit, s’en est allé. Mon père parlait encore ce dialecte avec elle et son père à lui ; moi, en les entendant, j’ai fini par le comprendre, mais je ne suis plus capable de le parler, mon fils me demande parfois juste pour rire de lui dire comment on dit tel ou tel mot. Avec la disparition de ma génération, le wallon aura réellement disparu.
Pourquoi ? Est-ce une langue laide ? Abâtardie ? Moins agréable que le courtraisien, le brugeois ou l’ostendais ? Dois-je maintenant descendre dans la rue en réclamant des cours de wallon à l’école en arguant du fait qu’avec un peu de chance, dans le fin fond du Wisconsin, on risque de trouver un vieux Namurois capable de lâcher deux ou trois mots de wallon tout en sirotant une Belgian beer ? Non, le wallon est fini, bien fini, comme le brabançon, le bruxellois, le champenois, le francique, le gaumais, le luxembourgeois (en tant que langue pratiquée en Belgique) ou le picard… Ils ont tous disparu. Ce n’étaient tout simplement pas les langues de la culture, des livres, du commerce, et pas les langues grâce auxquelles on pouvait s’élever dans la société. C’est la même chose à Arlon, une ville qui, à l’origine, est de langue germanique et de culture allemande. Depuis le XIIIe siècle, la langue commune des habitants, des relations familiales et traditionnelles avec le Grand-Duché est le luxembourgeois, et il a fallu plus d’un siècle de francisation pour que plus de 50 % d’Arlonais parlent le français, et cela ne fut le cas que dans les années trente.
Un autre exemple ? La France a intégré combien de parlers différents ? Dix, quinze ? Dans les Alpes Maritimes, toutes les plaques de villages sont traduites en italien et on mange des gnocchi, en Bretagne le folklore du cru est fort et omniprésent, mais le fait d’avoir dû eux aussi, comme beaucoup d’autres, abandonner leur parler ancien n’en fait pas pour autant (hormis quelques individus qui, par le passé, faisaient de temps en temps sauter une petite bombe) des séparatistes forcenés (aux alentours de 5 % aux élections).
Une anecdote sur ces Bretons justement, et à mettre en rapport avec ces Flamands qui seraient morts par dizaines dans les tranchées de 14-18 (sans qu’on en trouve de trace par ailleurs dans les écrits qu’ils ont laissés), faute de comprendre les ordres de leur officier (officiers flamands parlant le français, je m’empresse de l’ajouter), alors que dans une tranchée, le fait de vivre ensemble ou même simplement le langage des signes permet rapidement d’arriver à un niveau de communication suffisant pour éviter de faire des bêtises coûteuses. Une anecdote bretonne donc. C’est en 1914 qu’est apparu le terme baragouiner, car les soldats français mais… bretons ne parlant bien souvent pas un mot de français demandaient avec véhémence leur bara, c’est-à-dire du pain, et leur gwin, c’est-à-dire leur ration de vin à des officiers, pourtant du même pays qu’eux, qui ne comprenaient pas ce que leurs hommes disaient ou baragouinaient. On attend cependant toujours les plaintes des descendants des poilus bretons pour décès dus à la non-compréhension des ordres… Dernier petit détail, l’armée de Napoléon comportait des soldats de toutes les nationalités, dont de nombreux Flamands d’ailleurs. Loin de parler tous le français, chargeaient-ils tous à tout-va sans rien comprendre ? Si certains le pensent, je leur conseille de lire soit en néerlandais soit en français, car elles ont été traduites les mémoires de Jeff Abbeel, qui, flamand de Belgique, servit de 1806 à 1812 dans les carabiniers, l’élite de la cavalerie française.